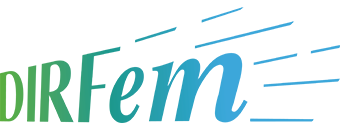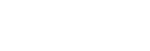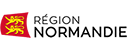« L’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit –on dira aussi « formé », « modelé », « façonné », « fabriqué », « conditionné », – par la société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours duquel l’individu acquiert – « apprend », « intériorise », « incorpore », « intègre », des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées socialement » (Muriel Darmon, La socialisation, 2006)
Socialisation de genre signifie un apprentissage par les garçons et petites filles de « rôles sexués » différents ; des « rôles sexués » qui s’opposent et construisent une identité de genre soit féminin soit masculin.
Archives
« Le concept de stéréotype de sexe indique seulement que chaque garçon et chaque fille est contraint de construire son identité personnelle en prennat position par rapport à des attentes sociales traditionnellement propore à son sexe. On ne peut exclure, dans les millions de socialisations individuelles, ni les possibilités de transgression ni les combinaisons inattendues de la part des acteurs, qu’il s’agisse d’innovations personnelles ou collectives. Les chercheurs féministes américaines ont fortement insisté sur la nécessité de ne pas confondre les modèles sociaux avec les compportements effectifs des individus, beaucoup plus variables. Tout ce que le sociologie est amené à constater, c’est que la construction de l’identité personnelle ne s’effectue pas dans les mêmes conditions pour les garçons et pour les filles. C’est ce répertoire virtuel d’attentes sociales que nous appelons stéréotypes ».(Ref. Christian Baudelot, Roger Establet, Allez les filles !, Points Actuels, Editions du Seuil, Paris, 1992. p. 72.
Sujet de société / Fait de société : Phénomène caractéristique de tendances dans la vie sociale d’un pays ou d’un groupe (le rapport à l’éducation, au mariage, au divorce, à l’urbanisation, à la consommation d’énergie, à la violence, à l’inceste, etc.)
On parle du passage du fait divers (événement isolé) au fait de société lorsqu’un phénomène social (répété et souvent dysfonctionnel) est mieux compris, que son fonctionnement, en tant que mécanisme social, est démontré, ou son importance chiffrée connue. Une telle transformation apporte un nouveau regard sur un sujet ancien. Par exemple, le passage de la catégorie « crime passionnel » à la catégorie « féminicides », illustre la reconnaissnace du nombre et de la fréquence des cas d’une part, et d’autre part signale le changement de statut que la société accorde à ces faits. Echappant désormais à la disqualification des faits divers, le féminicide conçu comme un fait de société mérite un traitement politique et juridique à la hauteur du crime ainsi désigné.
Pour un exemple du passage du fait divers au fait de société : Amandine KERVELLA, « Du fait divers au fait de société : l’affaire du RER D », Les Cahiers du journalisme n o 17 – Été 2007, pp. 284-294.
Pour aller plus loin : Rose Lamy, Défaire le discours sexiste dans les médias, Paris, JC Lattès, 2021.

Suzanne Buisson, née Lévy, est une femme politique socialiste et une résistante française, née le dans le 9e arrondissement de Paris et morte en déportation à Auschwitz (Pologne) le .

Taslima Nasreen, ou Taslima Nasrin, née le à Mymensingh, est une femme de lettres d’origine bangladaise qui milite pour les droits des femmes. Taslima Nasreen a acquis en Occident l’image d’une combattante pour l’émancipation des femmes et la lutte contre ce qu’elle appelle l’obscurantisme religieux de son pays d’origine, le Bangladesh.

Toni Morrison, née Chloe Ardelia Wofford le à Lorain dans l’État de l’Ohio et morte le à New York, est une romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et directrice de publication américaine. Elle est lauréate du prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de littérature en 1993 pour lequel elle est la huitième femme et la première Afro-Américaine à avoir reçu cette distinction.
« Dès la renaissance du mouvement féministe dans les pays occidentaux, entre 1968 et 1970, la question du travail ménager ou domestique est posée par les féministes qui affirment son caractère de travail. Trois décennies plus tard, on peut constater que, sur ce point, le féminisme a réussi, et que la perception du « travail de la maison » comme vrai travail n’est plus guère mise en cause dans la société. […] La double journée, c’est cela : les femmes françaises « actives » (ayant une activité rémunérée) et ayant entre un et trois enfants travaillent en moyenne huitante-trois heures par semaine. La question que l’on se pose dans les milieux féministes et que l’on appelle la question du « partage des tâches » est la suivante : comment faire pour que les hommes en fassent plus et les femmes moins, comment faire pour égaliser le temps de travail ménager des femmes et des hommes, donc pour réaliser l’égalité sur ce plan dans les couples hétérosexuels. […] À la théorie du « profit pour le capitalisme », j’oppose depuis longtemps celle du « profit pour la classe des hommes ». Ou, en d’autres termes, le travail ménager n’est pas une somme disparate de relations individuelles mais l’effet d’un mode de production, le mode de production patriarcal ou domestique. Qu’est-ce que le mode de production patriarcal ? C’est justement l’extorsion, par le chef de famille, du travail gratuit des membres de sa famille. C’est ce travail gratuit réalisé dans le cadre social – et non géographique – de la maison que j’appelle le travail domestique. » (Ref. : DELPHY Christine, « Par où attaquer le « partage inégal » du « travail ménager » ? », Nouvelles Questions Féministes, 2003/3 (Vol. 22), p. 47-71. DOI : 10.3917/nqf.223.0047. URL : https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2003-3-page-47.htm).

Virginia Woolf, née Adeline Virginia Alexandra Stephen le à Londres et morte le à Rodmell (Royaume-Uni), est une autrice et femme de lettres britannique. Elle est l’un des principaux écrivains modernistes du xxe siècle. Dans l’entre-deux-guerres, elle est une figure marquante de la société littéraire londonienne et une membre centrale du Bloomsbury Group, qui réunit des écrivains, artistes et philosophes anglais. Les romans Mrs Dalloway (1925), La Promenade au phare (1927), Orlando (1928) et Les Vagues (1931), ainsi que l’essai féministe Une chambre à soi (1929), demeurent parmi ses écrits les plus célèbres.
Ensemble des normes sociales et culturelles qui renvoient aux attributs et attitudes généralement attendus des hommes dans la société patriarcale (pilosité, corps musclés, comportements violents, i.e.) et à la valorisation sociale de ceux-ci. L’objectif de ces normes est d’assurer la perpétuation de la domination masculine, de l’exercice du pouvoir par les hommes. Une partie de ses comportements et attitudes sont aujourd’hui reconnu comme toxique. Ils enferment les hommes dans un des registres/des formes de la masculinité.
« Il croyait viril d’imposer ses caprices ; mais on lui cédait comme à une femme nerveuse » (Simone de Beauvoir, Mandarins, Paris, Gallimard, 1954, p. 109).
Voir virilité.
Voir masculinisme.
« […] la critique féministe, après avoir dénoncé le caractère aliénant des modèles traditionnels de féminité, s’est attachée, dans le courant des années 1970, à dissocier la masculinité des stéréotypes virils. En montrant que la virilité n’était pas un attribut naturel du mâle mais le fruit d’un ensemble de processus éducatifs et sociaux visant à perpétuer la domination masculine, ses détracteurs souhaitaient non seulement ouvrir un nouveau front dans la lutte pour l’égalité entre les sexes, mais également « donner des armes aux hommes désireux d’abandonner la parodie virile classique » et se libérer de ce « mythe terroriste »*. « (Réf : Arnaud Baudérot, « On ne naît pas viril, on le devient » ; Jean-Jacques Courtine (Dir.), Histoire de la virilité. La virilité en crise, Paris, Editions du Seuil, p.173 ; *Georges Falconnet et Nadine Lefaucheur, La fabrication des mâles, Paris, Seuil, 1975. p.65.)
« D’apparence universelle, inaltérable, car inscrite naturellement dans le corps, la virilité n’aurait pas de quoi « faire histoire ». Et pourtant de l’Antiquité jusqu’aux Lumières (tome 1), puis tout au long du XIXe siècle (tome 2), les qualités de la virilité ont été mises en valeur de manière variable : supériorité, force et grandeur physiques autant que morales, en sont les valeurs constitutives. Entre les XXe et XXIe siècles (tome III), l’histoire de la virilité se dessine dans un horizon trouble, par une crise, à l’intérieur même d’une « zone de turbulences culturelles, un champ d’incertitudes, une période de mutation » (p. 10). » (Réf. Guérin, Laura. « Alain Corbin, Jean Jacques Courtine & Georges Vigarello (dir.), Histoire de la virilité : Tome 3, La virilité en crise ? Le xxe-xxie siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2011, 566 p. », Corps, vol. 14, n°1, 2016, pp. 185-190).